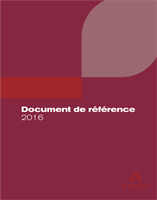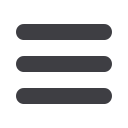

LEXIQUES
1. Lexique technique
> Récupération de chaleur
Les centrales à récupération de chaleur utilisent la chaleur résiduelle issue de
processus industriels pour générer de l’électricité. Cette technologie consiste
à transférer la chaleur vers une chaudière à récupération de chaleur pour
en reproduire, ainsi que de l’électricité
via
une turbine à vapeur. Les centrales
à récupération de chaleur permettent de réduire la demande énergétique des
installations industrielles et, par conséquent, de diminuer leurs émissions de CO
2
.
> Récupération
in situ
Méthode d’exploitation qui consiste à extraire une substance minérale par mise en
solution de cette substance dans la couche géologique qui la contient par injection
d’une solution oxydante acide ou alcaline. On parle aussi de « lixiviation
in situ
».
> Recyclage des combustibles nucléaires usés
Après un séjour de trois à quatre années en réacteur, le combustible nucléaire usé
doit être déchargé. Il contient alors encore environ 96 % de matières valorisables
(95 % d’uranium et 1 % de plutonium) et 4 % de produits de fission et actinides
mineurs (déchets ultimes). L’opération de traitement consiste à séparer les
matières radioactives valorisables des déchets radioactifs ultimes contenus dans le
combustible usé (qui sont conditionnés pour être stockés) en vue de leur recyclage.
Le recyclage permet une économie significative des ressources naturelles.
> Réexamen de sûreté
Le réexamen de sûreté d’une installation permet d’apprécier la situation
de l’installation au regard des règles qui lui sont applicables et d’actualiser
l’appréciation des risques ou inconvénients que l’installation peut présenter en
tenant compte notamment de l’état de l’installation, de l’expérience acquise au
cours de l’exploitation, de l’évolution des connaissances et des règles applicables
aux installations similaires.
> Référentiel de sûreté
Ensemble des documents présentant les dispositions permettant d’assurer la sûreté
d’une installation (l’analyse de sûreté en fait partie). Il est notamment constitué :
p
d’un décret (si l’installation a été créée ou modifiée après 1963) et du dossier
de demande d’autorisation ;
p
de prescriptions édictées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;
p
d’un Rapport de sûreté (RDS) et de règles générales d’exploitation (RGE) ou
règles générales de surveillance et d’entretien (RGSE) ;
p
d’une étude sur la gestion des déchets de l’installation faisant état des objectifs
pour en limiter le volume et la toxicité ;
p
d’un Plan d’urgence interne (PUI) qui peut comporter des parties communes à
l’ensemble du site nucléaire sur lequel est située l’installation.
> Règles générales de radioprotection
Document décrivant l’ensemble des dispositions prises pour assurer la protection
des personnes et la prévention contre le risque d’exposition aux rayonnements
ionisants.
> REP (réacteur à eau sous pression)
Réacteur nucléaire modéré et refroidi par de l’eau ordinaire, maintenue liquide
dans le cœur grâce à une pression appropriée dans les conditions normales de
fonctionnement.
> Ressources/réserves
Les réserves sont constituées des stocks de minerai connus avec certitude et
exploitables techniquement à court terme à un coût économique compétitif. Les
ressources sont constituées, en plus des réserves, par des stocks de minerai dont
l’existence est seulement présumée ou estimée avec une certaine probabilité, et
potentiellement exploitables à moyen ou long terme.
> RFS (Règles fondamentales de sûreté)
Règles destinées à expliciter les conditions dont le respect est, pour le type
considéré d’installations et pour l’objet dont elles traitent, jugé comme valant
conformité avec la pratique réglementaire française.
> RGE (Règles générales d’exploitation)
Document décrivant le mode de fonctionnement défini pour l’installation en
indiquant les éléments importants pour la sûreté. Il décrit les dispositions prises
en exploitation en cas de sortie du mode de fonctionnement normal.
> Rotor
Élément d’une éolienne composé de plusieurs pales (en général trois) qui
sont fixées à un moyeu central, lui-même relié à la nacelle.
Le rotor entraîné par le vent produit de l’énergie mécanique, qui est
ensuite transformée en énergie électrique par le générateur.
> Sécurité nucléaire
Selon la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire (loi « TSN »), la sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la
radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que
les actions de sécurité civile en cas d’accident. Dans une acception plus proche de
la définition de l’AIEA, il s’agit de la prévention, de la détection et de la réaction au vol,
au sabotage, à l’accès non autorisé, au déplacement illégal de matières nucléaires
ou à tout autre acte malveillant concernant des matières nucléaires, toutes autres
substances radioactives ou les installations qui les contiennent.
> Sites EES (Sites à enjeux environnementaux significatifs)
Dans le référentiel AREVA, ce sont les sites nucléaires, les sites comprenant des
installations à risques technologiques majeurs du type Seveso, les sites miniers en
exploitation, les établissements industriels comprenant des installations soumises
à enquête publique et les sites industriels ou tertiaires dont les contributions en
matière de consommations, de rejets ou de nuisances apparaissent significatives
dans la comptabilité environnementale du groupe.
> Stator
Élément statique du moteur électrique (par exemple un groupe motopompe
primaire) ou d’un alternateur.
> Stériles miniers
Terre, sable ou roche ne contenant pas ou peu d’uranium, mais qu’il faut extraire
pour pouvoir accéder au minerai lui-même. Les stériles miniers présentent une
radioactivité naturelle, de l’ordre de celle des roches environnantes.
> Stockage de déchets radioactifs
Opération consistant à placer des déchets radioactifs dans une installation
spécialement conçue afin de les isoler de façon définitive de l’Homme et
de l’environnement, dans le respect des principes énoncés par le Code de
l’environnement.
380
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016