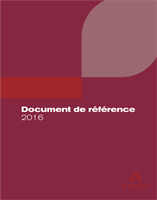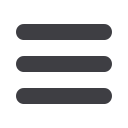

LEXIQUES
1. Lexique technique
> Filière (de réacteurs)
Famille de réacteurs présentant des caractéristiques générales communes.
> Fissile
Se dit d’un nucléide capable de fissionner ; cette fission des atomes générant
plusieurs neutrons.
> Fission
Éclatement spontané ou forcé, généralement après absorption d’un neutron, d’un
noyau lourd en deux ou trois noyaux plus petits (produits de fission), accompagné
d’émission de neutrons, de rayonnements et d’un important dégagement de
chaleur. Cette libération importante d’énergie constitue le fondement de la
production d’électricité d’origine nucléaire.
> Fluide caloporteur
Fluide circulant dans le cœur d’un réacteur nucléaire ou dans le receveur d’un
générateur de vapeur solaire pour en transporter la chaleur.
> Fusion thermonucléaire
La fusion d’atomes légers (comme l’hydrogène) est le processus nucléaire à l’origine
de l’énergie des étoiles, comme le soleil. La fusion est l’inverse de la fission, car
elle correspond à la réunion de noyaux d’atomes.
> Gaine
Tube métallique étanche (constituant la partie externe du crayon) dans lequel est
inséré le combustible nucléaire pour le protéger de la corrosion par le caloporteur
et empêcher la dispersion des produits de fission. La gaine constitue la première
barrière de confinement. Dans les réacteurs à eau pressurisée, les gaines sont en
zircaloy (alliage de zirconium).
> Générateur de vapeur
Échangeur de chaleur assurant dans un REP le transfert de chaleur de l’eau du
circuit primaire à l’eau du circuit secondaire. Cette dernière y est transformée en
vapeur, qui entraîne une turbine couplée à un alternateur produisant de l’électricité.
> Génération IV
Filière de réacteurs ou systèmes nucléaires innovants susceptibles d’être mis en
service à horizon 2040-2050. Ils sont étudiés dans le cadre d’une collaboration
internationale appelée Forum international génération IV (FIG) auquel participe la
France. Ces systèmes visent en particulier à répondre à la nécessité de réduire la
quantité de déchets produits, d’économiser les ressources, de garantir une sûreté
et une fiabilité accrue pour les réacteurs nucléaires du futur.
> GIEC (Groupement intergouvernemental sur l’évolution
du climat) ou IPCC
(Intergouvernemental Panel on Climate
Change)
Créé en 1988 à l’initiative des pays du G7 et constitué d’experts de l’ONU, il
relève aujourd’hui de l’Organisation météorologique mondiale dans le cadre du
Programme pour l’environnement des Nations Unies. Son rôle consiste à expertiser
l’information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque
de changement climatique provoqué par l’homme. À ce titre, il a fait paraître
plusieurs rapports qui pronostiquent notamment une augmentation moyenne des
températures mondiales, en un siècle.
> Grappe de contrôle ou de commande (voir
Barres
de contrôle
)
Équipement contenant des éléments absorbant les neutrons, permettant le contrôle
de la réaction de fission en chaîne dans un réacteur nucléaire. L’introduction des
grappes de contrôle, dans le cœur, réduit ou arrête la réaction en chaîne.
> Groupe motopompe primaire
Motopompe assurant la circulation de l’eau du circuit primaire dans un réacteur
à eau pressurisée. Tournant à près de 1 500 tours/minute, une pompe primaire
débite environ 20 000 m
3
d’eau/heure.
> HCTISN (Haut Comité pour la transparence et l’information
sur la sûreté nucléaire)
Instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux
activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur
l’environnement et sur la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis sur
toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et l’information qui s’y
rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de
l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature
à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
> HFDS (Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité)
La responsabilité du contrôle des matières nucléaires est confiée par le Code
de la défense au ministre chargé de l’Énergie pour les matières nucléaires à
usage civil. À ce jour, en raison de la répartition actuelle des compétences au
sein du gouvernement, cette responsabilité est confiée conjointement au ministre
de l’Économie et des Finances et à la ministre de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer. Pour exercer ces responsabilités, les ministres s’appuient sur un
service (le service de défense de sécurité et d’intelligence économique) constitué
de personnels en charge de l’instruction des dossiers et de l’élaboration de la
réglementation. Ce service est placé sous la responsabilité du Haut Fonctionnaire
de défense et de sécurité auprès de la ministre de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer qui assure la fonction d’autorité de sécurité nucléaire.
> ICPE (Installation classée pour la protection
de l’environnement)
Installation et activité « visées dans la nomenclature des installations classées
pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du
voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ou l’agriculture, la protection
de la nature, de l’environnement et des paysages, ou encore la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
> Îlot nucléaire
Ensemble englobant la chaudière nucléaire et les installations relatives au
combustible, ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement et à la
sécurité de cet ensemble. La turbine, l’alternateur générant l’électricité qui y est
accouplée, et les équipements nécessaires au fonctionnement de cet ensemble
constituent « l’îlot conventionnel ».
> INB (Installation nucléaire de base)
En France, installation qui, par sa nature ou en raison de la quantité ou de l’activité
de toutes les substances radioactives qu’elle contient, est visée par la nomenclature
INB et soumise à la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire et à ses textes d’application. La surveillance des INB est exercée
par des inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). À titre d’exemple, un
réacteur nucléaire, les usines d’enrichissement, de fabrication de combustibles ou
encore de traitement des combustibles usés sont des INB.
376
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016