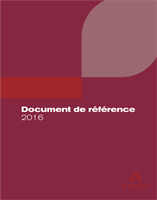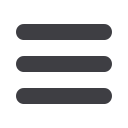

LEXIQUES
1. Lexique technique
> Chaudière nucléaire
Système de production de vapeur dont la chaleur est fournie par un réacteur
nucléaire.
Dans un Réacteur à eau sous pression (REP), elle est constituée de composants
lourds (générateur de vapeur, pressuriseur, cuve de réacteur), de composants
mobiles (groupemotopompes primaires et mécanismes de commande de grappes)
et des tuyauteries reliant ces équipements. C’est l’ensemble de tous ces éléments
interconnectés qui permet de faire circuler l’eau chaude et de la maintenir à l’état
liquide dans le circuit primaire du réacteur. La chaleur est produite par la fission
des noyaux d’atomes contenus dans le combustible placé au cœur du réacteur,
dans la cuve.
> CI (Commission d’information)
Instituée auprès des sites nucléaires intéressant la Défense Nationale, elle a pour
mission d’informer le public sur l’impact des activités nucléaires sur la santé et
l’environnement.
> CLFR (réflecteurs à miroirs linéaires de Fresnel)
Technologie utilisant des rangées de miroirs plats ou très peu incurvés pour
concentrer les rayons du soleil vers un récepteur linéaire horizontal fixe, composé
d’un tube ou d’un ensemble de tubes, à l’intérieur duquel circule le fluide
caloporteur. Le fluide thermodynamique est chauffé par les rayons incidents du
soleil. Dans le cas où ce fluide est de l’eau, on parle de technologie DSG
(Direct
SteamGeneration)
. L’énergie lumineuse est convertie en énergie thermique : l’eau
est chauffée puis transformée en vapeur et ensuite éventuellement surchauffée.
Cette vapeur peut être ensuite utilisée, soit directement pour alimenter des procédés
industriels en vapeur, soit envoyée vers une turbine pour produire de l’électricité.
> CLI (Commission locale d’information)
Instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires
de base (INB), elle est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et
de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des
activités nucléaires du site sur les personnes et l’environnement. La CLI assure la
diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au public.
> CLIC (Comité Local d’Information et de Concertation)
Institué auprès de toute installation industrielle chimique dite « Seveso seuil haut »,
le CLIC a pour mission de créer un cadre d’échanges et d’informations sur les
actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des
pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d’accidents majeurs que peuvent
présenter les installations.
> CLIGEET
Commission locale d’information auprès des grands équipements énergétiques
du Tricastin (nom de la CLI du site du Tricastin).
> CLIS (Comité Local d’Information et de Suivi)
Institué auprès du laboratoire souterrain de Bure, il est chargé d’une mission
générale de suivi, d’information et de concertation en matière de recherche sur la
gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets
en couche géologique profonde.
> Cœur d’un réacteur
Constitué par le combustible nucléaire dans la cuve du réacteur, il est agencé pour
être le siège d’une réaction de fission en chaîne entretenue.
> Cogénération
Production combinée de chaleur et d’électricité à partir d’une même centrale de
production. Un ou plusieurs combustibles peuvent être utilisés : biomasse, gaz de
fermentation (méthane), gaz naturel, charbon, fioul, etc.
> Combustible nucléaire usé
Combustible définitivement retiré du cœur d’un réacteur après avoir été irradié.
> Concentré d’uranium
(yellow cake)
Uranate de magnésie, de soude, d’ammoniumou peroxyde d’uranium, sous forme
solide, résultant du traitement mécanique et chimique du minerai d’uranium. Ce
concentré marchand contient environ 80 % d’uranium.
> Conditionnement
Conditionnement des déchets radioactifs : opération d’emballage des déchets
sous une forme appropriée au confinement des matières radioactives, pour en
permettre le transport, le stockage et le dépôt définitif.
p
Les déchets radioactifs de très faible activité (vinyle, chiffons de nettoyage, etc.)
sont conditionnés en fûts, dans des sacs résistants
(big bags)
, ou dans des
casiers de grand volume. Les gravats de très faible radioactivité sont mis en vrac
dans des sacs spéciaux (les
big bags
).
p
Les déchets de faible et moyenne activité, après avoir subi autant que possible
une réduction de volume, sont conditionnés de manière spécifique (bloqués
ou enrobés dans une matrice spéciale de béton, bitume ou résine). La matrice
de blocage ou d’enrobage permet de confiner les toxiques et radiotoxiques au
sein du colis de déchets.
p
Les déchets de haute activité sont vitrifiés et coulés dans des conteneurs en
acier inoxydable.
> Confinement
Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à l’intérieur
d’un périmètre défini.
> Contamination
Présence de substances radioactives (poussières ou liquides) à la surface ou à
l’intérieur d’un milieu. Pour l’Homme, la contamination peut être externe (sur la
peau) ou interne à l’organisme (par inhalation, ingestion ou voie transcutanée).
> Contrôle-commande
Ensemble des systèmes électroniques et électriques qui permettent d’effectuer le
pilotage, c’est-à-dire d’effectuer les mesures, d’actionner les dispositifs de régulation
de paramétrage, et d’assurer la sécurité de fonctionnement d’une centrale nucléaire
ou de tout autre système industriel complexe.
> Contrôle des matières nucléaires
Il porte sur deux aspects :
p
l’ensemble des dispositions prises par les exploitants pour assurer la sécurité
des matières qu’ils détiennent (suivi et comptabilité, confinement, surveillance,
protection physique des matières et des installations, protection en cours de
transport) ;
p
le contrôle exercé par l’État (Haut fonctionnaire de défense et de sécurité) ou
par des organismes internationaux (AIEA, Euratom…) pour vérifier l’efficacité et
la fiabilité de ces dispositions.
Dans les deux cas, le contrôle vise à prévenir toute perte ou détournement de
matière en particulier à des fins malveillantes.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
373