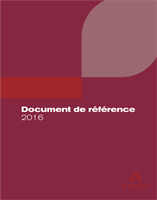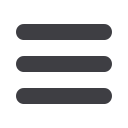

LEXIQUES
1. Lexique technique
> Nacelle
Installée au sommet de la tour d’une éolienne, la nacelle abrite généralement les
composants mécaniques, pneumatiques, électriques et électroniques, nécessaires
au fonctionnement de lamachine (système d’orientation, multiplicateur, générateurs,
convertisseur, contrôle commande…).
Sur presque toutes les éoliennes à axe horizontal, une orientation forcée est utilisée.
Les nacelles sont donc munies d’un dispositif qui utilise des moteurs électriques et
des multiplicateurs pour s’assurer que le rotor – et donc la nacelle – soit toujours
orienté face au vent.
> Neutron
Particule électriquement neutre qui entre, avec les protons, dans la composition
du noyau de l’atome.
> Non-prolifération
Ensemble des moyens politiques ou techniques mis en œuvre pour combattre
la prolifération. Les régimes internationaux de non-prolifération sont l’ensemble
des instruments internationaux et des politiques qui concourent à la prévention
de l’accès par des États, en violation de leurs engagements internationaux, à des
armes de destruction massive ou à leurs vecteurs. Le Traité de non-prolifération
(TNP) repose sur la discrimination entre les États dotés ou non de l’arme nucléaire.
Les États dotés d’armes nucléaires (EDAN) s’interdisent de transférer leur savoir
en la matière aux États non dotés d’armes nucléaires (ENDAN). Ces derniers
s’engagent, quant à eux, à ne pas chercher à acquérir une force de frappe nucléaire.
En échange, les ENDAN ont droit à l’accès aux technologies nucléaires pacifiques.
> Norme OHSAS 18001
Modèle de Système de management de la santé et de la sécurité au travail
(SMS&ST), autrement dit de prévention de risques professionnels. Son objectif est
de fournir aux entreprises le souhaitant un support d’évaluation et de certification
de leur système de management de la santé et de la sécurité au travail, compatible
avec les normes internationales de système de management comme ISO 9001
pour la qualité, ISO 14001 pour l’environnement et ILO-OSH 2001 pour la sécurité
et la santé au travail.
> Normes ISO
Normes internationales. Les normes ISO de la série 9000 fixent les exigences
d’organisation ou de système de management de la qualité pour démontrer la
conformité d’un produit ou d’un service notamment à des exigences clients. Les
normes ISO de la série 14000 prescrivent les exigences d’organisation ou de
Système de management environnemental pour prévenir toute pollution et réduire
les effets d’une activité sur l’environnement.
> NRC
(Nuclear Regulatory Commission)
Homologue de l’ASN aux États-Unis.
Domaine de compétence : sûreté nucléaire et radioprotection.
> Opérations de fin de cycle
Ensemble des obligations réglementaires de mise à l’arrêt et de démantèlement
des installations nucléaires et de gestion des déchets radioactifs.
> ONR
(Office for Nuclear Regulation)
Homologue de l’ASN au Royaume-Uni.
Domaine de compétence : sûreté nucléaire et radioprotection.
> Pales
Les pales d’éolienne captent l’énergie cinétique du vent et la convertissent en
énergie mécanique sous la forme d’une poussée de type portance.
Leur assemblage en rotor, par le biais d’un moyeu central, permet de transformer
cette poussée linéaire en un effort de couple plus facilement exploitable.
> Période radioactive (ou demi-vie)
Pour un radionucléide donné, temps nécessaire à la désintégration de la moitié
des noyaux en question dans une quantité de matière. Au bout de ce temps,
sa radioactivité a donc diminué de moitié. Aucune action physique extérieure ne
peut modifier la période d’un radionucléide, sauf à le « transmuter » en un autre
radionucléide, par exemple par capture d’un neutron. La période radioactive est
ainsi une caractéristique physique d’un radionucléide donné.
> Pile à combustible
(Fuel Cell)
Système électrochimique qui convertit directement en énergie électrique l’énergie
chimique de la réaction d’oxydation d’un combustible.
Sous sa forme la plus simple, une pile à combustible comprend deux électrodes
(anode et cathode) et est alimentée par des couples oxydo-réducteurs susceptibles
de réaliser un équilibre avec les ions contenus dans l’électrolyte. Dans ces piles à
combustible l’oxydant est soit l’oxygène pur, soit l’oxygène de l’air. Les réducteurs
les plus utilisés sont gazeux (hydrogène ou méthanol), liquides (hydrocarbures ou
méthanol) ou solides (zinc, aluminium…).
Contrairement aux accumulateurs dont l’énergie dépend des matières actives
incorporées dans les électrodes, une pile à combustible met en jeu des espèces
chimiques réactives issues d’une source extérieure (à la pile), les espèces formées
sont constamment éliminées, lui assurant ainsi un fonctionnement théoriquement
continu.
> Piscine d’entreposage des combustibles usés
Bassins dans lesquels sont entreposés, pour refroidissement et désactivation, les
combustibles usés après leur déchargement d’un réacteur.
> Plan d’opération interne (POI)
Description des règles d’organisation, des moyens en place et disponibles sur un
site industriel afin de minimiser les conséquences d’un sinistre potentiellement
majeur pour les personnes, l’environnement et les biens. C’est une organisation
qui peut être rendue obligatoire par la réglementation selon l’article R. 512-29 du
Code de l’environnement (installation ICPE classée AS, toute autre installation suite
à décision préfectorale et certaines installations particulières comme les entrepôts
de plus de 50 000 m
2
).
> Plan d’urgence et d’intervention transport (PUI-T)
En cas d’incident lors d’un transport de matières radioactives, un plan d’urgence
et d’intervention transport (PUI-T) est instantanément activé. Celui-ci couvre les
phases d’alerte, d’analyse de la situation et d’intervention sur le terrain suite à un
incident ou un accident de transport de matières radioactives. Il permet de mettre
à la disposition des autorités compétentes des moyens humains spécialisés et des
matériels spécifiques. L’ensemble de ce dispositif est testé, en moyenne, chaque
année à l’échelon national avec les principaux acteurs et notamment les autorités
compétentes.
> Plan d’urgence interne (PUI)
Description de l’organisation, des méthodes d’intervention et des moyens destinés
à faire face aux situations d’urgence (incident ou accident) pour protéger des
expositions aux rayonnements ionisants le personnel, le public et l’environnement
et préserver la sûreté de l’installation nucléaire de base.
378
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016