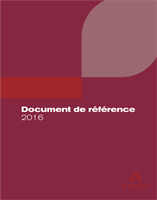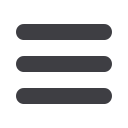

LEXIQUES
1. Lexique technique
> Dose
Mesure de l’exposition d’un individu à des rayonnements ionisants (énergie reçue
et effets liés à la nature des rayonnements). La dose se mesure en milliSievert
(mSv), sous-unité du Sievert (Sv) - 1 Sv = 1 000mSv. La dose moyenne d’exposition
d’origine naturelle d’un individu en France est de 2,4 mSv/an.
> Dosimètre
Instrument permettant de mesurer des doses radioactives reçues par un individu
ou par certains organes de cet individu (dosimètre passif ou opérationnel), ou par
l’environnement (dosimètre de site).
> Eau ordinaire ou « légère »
Constituée d’hydrogène et d’oxygène (alors que l’eau lourde est une combinaison
d’oxygène et de deutérium), elle est utilisée dans certains réacteurs à la fois pour
refroidir le combustible et récupérer l’énergie produite, et pour ralentir les neutrons
afin d’augmenter la probabilité de fission.
> Échelle ARIA
Échelle européenne des accidents industriels officialisée en février 1994 par
le Comité des autorités compétentes des États membres pour l’application de
la directive Seveso. Elle repose sur dix-huit paramètres techniques destinés à
caractériser objectivement les effets ou les conséquences des accidents : chacun
de ces paramètres comprend six niveaux. Le niveau le plus élevé détermine l’indice
de l’accident.
> Échelle INES
(International Nuclear Event Scale)
Échelle internationale conçue par l’AIEA pour faciliter la communication sur les
événements nucléaires. Elle permet de disposer d’éléments de comparaison et
d’ainsi mieux juger de leur gravité. Elle est graduée de 0 (écart sans importance
du point de vue de la sûreté) à 7 (accident majeur avec des effets considérables
sur la santé et l’environnement).
L’application de l’échelle INES se fonde sur trois critères :
p
les rejets radioactifs à l’extérieur du site ;
p
les conséquences à l’intérieur de l’installation (dégâts ou dommages au
personnel) ;
p
la dégradation de la défense en profondeur.
> Écoconception
Conception d’un produit ou d’une installation industrielle contribuant à réduire
la consommation de ressources naturelles et à limiter les rejets susceptibles
d’impacter l’environnement.
> Électrolyseur
Système électrochimique (récepteur d’énergie) qui permet de dissocier l’eau liquide
en oxygène et en hydrogène, sous l’effet d’un courant électrique passant entre deux
électrodes. Les ions produits par les réactions d’oxydoréduction circulent librement
pour passer d’une électrode à l’autre. Les deux électrodes (cathode : siège de la
réaction de réduction et anode : siège de la réaction d’oxydation) sont reliées par
l’électrolyte et par le générateur de courant électrique.
Dans l’électrolyseur alcalin, l’électrolyte est une solution de potasse circulante ou
immobilisée dans une matrice de rétention et, dans l’électrolyseur à membrane,
l’électrolyte prend la forme d’une membrane échangeuse d’ions à conduction
protonique.
> Élément chimique
Catégorie d’atomes ayant en commun lemême nombre de protons dans leur noyau.
> Emballage
Structure permettant de contenir de façon sûre la matière radioactive transportée.
Il peut inclure différents matériaux spécifiques (comme ceux absorbant les
rayonnements ou ceux assurant une isolation thermique), des équipements de
service, des structures antichocs, des dispositifs pour la manutention et l’arrimage.
> Embout
Pièce métallique située en partie supérieure (embout de tête) ou inférieure (embout
de pied) d’un assemblage de combustible. L’embout de tête sert en particulier à
la manutention de l’assemblage.
> Énergie renouvelable
Énergie produite à partir de sources renouvelables, non fossiles, reproductibles à
l’échelle d’une génération humaine.
> Enrichissement
Procédé par lequel on accroît la teneur en isotopes fissiles d’un élément chimique.
Ainsi, l’uranium, essentiellement constitué à l’état naturel de 0,7 %de
235
U (fissile) et
de 99,3 % de
238
U (non fissile), doit être enrichi en
235
U pour être utilisable dans un
réacteur à eau pressurisée. La proportion de
235
U est portée aux environs de 3 à 5%.
> Entreposage
Dépôt temporaire de matières ou déchets radioactifs dans une installation
spécialement aménagée à cet effet, dans l’attente de les récupérer.
> Éolienne
Dispositif qui transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le plus
souvent cette énergie est elle-même transformée en énergie électrique.
> Équipements sous pression nucléaire (ESPN)
Équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires,
dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives.
Les équipements sous pression nucléaire sont classés :
p
en trois niveaux, de N1 à N3, en fonction notamment de l’importance des
émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ;
p
en cinq catégories, de 0 à IV, en fonction des risques, notamment ceux liés à la
température et à la pression des fluides qu’ils contiennent.
En France, l’arrêté du 12 décembre 2005, entré en vigueur depuis le 21 janvier 2011,
établit les conditions de mise sur le marché de tous les appareils et équipements
nucléaires.
> Euratom
Traité signé à Rome le 25 mars 1957, avec le traité fondateur de la CEE, il institue
la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), visant à établir « les
conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries
nucléaires ». Sa mission consiste à contribuer, par le développement de l’énergie
nucléaire, à la mise en commun des connaissances, des infrastructures et du
financement et à assurer la sécurité d’approvisionnement dans le cadre d’un
contrôle centralisé. Il rassemble les 28 pays membres de l’Union européenne.
> Exposition
Exposition d’un organisme ou d’un organe à une source de rayonnements ionisants,
caractérisée par la dose reçue.
> Fertile
Se dit d’un nucléide susceptible d’être transformé, par capture d’un neutron,
éventuellement suivie de désintégrations successives, en nucléide fissile.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
375