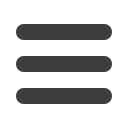

JURISPRUDENCE
110
forum
poenale
2/2008
Comment choisir la disposition à appliquer dans ce
contexte? Comme le rappelle le Tribunal fédéral, une par
tie de la doctrine, à la suite de Heine (Heine, Straftäter Un
ternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstra
frecht und Steuerstrafrecht, recht 2005, 1 ss.; Forster, Die
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach
Art. 102 StGB, th. St-Gall, Berne 2006) propose une appli
cation alternative automatique des art. 102 al. 1 CP et 7
DPA. Dans cette approche, l’art. 7 DPA n’entrerait en ligne
de compte qu’en matière de contraventions (l’art. 102 CP
ne s’appliquant pas aux infractions de degré contravention
nel), l’entreprise devant toujours répondre selon l’art. 102
al. 1 CP s’agissant des crimes et des délits.
Cette opinion peine cependant à convaincre. L’art. 7
DPA est en effet clairement une
lex specialis
par rapport
aux normes du code pénal. La possibilité ouverte par l’art.
7 DPA de rechercher l’entreprise dans les cas où la sanc
tion envisagée
in concreto
(et non la peine menace) ne dé
passe pas 5000 francs (ou 100 000 francs dans le contex
te de l’art. 87 LTVA et de l’art. 125 LD; ou encore 50 000
francs en application du futur art. 49 LFINMA) et que la
mise en évidence d’une responsabilité pénale individuelle
comporterait des efforts disproportionnés constitue en ef
fet une particularité de cette loi qui exclut l’application des
dispositions générales du code pénal, conformément
d’ailleurs aux art. 2 DPA et 333 al. 1 CP. Or il n’a jamais
été dans l’intention du législateur de paralyser, par l’adop
tion de la nouvelle partie générale du code pénal, la légis
lation accessoire de la Confédération, en particulier le
DPA. Ainsi, l’art. 7 DPA pourra toujours être appliqué
lorsque, dans le contexte d’infractions de degré délictuel
relevant en principe du DPA, les conditions de mise en
œuvre de l’art. 102 al. 1 CP seront également remplies
(Moreillon, La responsabilité pénale du chef d’entrepri
se et de l’entreprise, in: Assurance sociale, responsabilité
de l’employeur, assurance privée, Kahil-Wolff/Wyler
(éd.), Berne 2005, 97 ss.; Macaluso, La responsabilité pé
nale de l’entreprise, principes et commentaire des art.
100
quater
et 100
quinquies
CP, éd. Schulthess, Genève Bâle Zu
rich 2004, N 1121; Schmid, Strafbarkeit des Unterneh
mens: die prozessuale Seite, recht 2003, 223).
En matière délictuelle, c’est donc bien un choix entre l’art.
102 al. 1 CP et l’art. 7 DPA qui s’offre à l’autorité de pour
suite dans les cas de (relativement) peu de gravité. Malgré la
teneur ambiguë du Message sur ce point, il faut retenir que
si le choix est fait de poursuivre l’entreprise selon l’art. 102
al. 1 CP, il n’est alors pas envisageable de punir concurrem
ment l’entreprise en application de l’art. 7 DPA.
Comme le souligne le Tribunal fédéral dans l’arrêt re
produit ci-dessus, l’art. 7 DPA n’autorise pas l’autorité de
poursuite à renoncer à tout acte d’enquête permettant de
mettre en évidence une ou des responsabilités individuelles.
Là où des investigations
simples
permettront d’identifier un
auteur individuel (ou, comme le suggère le Tribunal fédéral
dans l’arrêt reproduit ci-dessus, d’aller rechercher la respon
sabilité de garant du chef d’entreprise), l’autorité de pour
suite devra y procéder avant que d’envisager de punir l’en
treprise.
Naturellement, l’obligation de rechercher par priorité un
auteur individuel à l’infraction est beaucoup plus forte dans
le contexte de l’application de l’art. 102 al. 1 CP. Le carac
tère pénal, au sens formel, de la disposition et l’importance
de la sanction possible (5000000 francs) font que l’autori
té de poursuite ne saurait renoncer à tenter d’imputer l’in
fraction à une personne physique déterminée au motif que,
comme c’est le cas dans le contexte de l’art. 7 DPA, cela né
cessiterait la mise en œuvre de moyens
«hors de proportion
avec la peine encourue»
. L’art. 102 al. 1 CP ne connaît pas
une telle condition. En ce sens, les efforts d’identification
d’un auteur individuel requis de l’autorité de poursuite sont,
ex lege
, moins importants dans le contexte de l’art. 7 DPA
que dans celui de l’art. 102 al. 1 CP.
D’ailleurs la pratique utilisait assez extensivement la pos
sibilité offerte par l’art. 7 DPA – les remarques formulées
par l’administration à l’appui de son recours sur le nombre
de cas liquidés de la sorte le démontrent.
L’arrêt reproduit ci-dessus marque pourtant une évolu
tion, sinon à proprement parler de la jurisprudence, du
moins de l’approche des infractions relevant du droit pénal
administratif: il paraît légitime aujourd’hui d’interpréter res
trictivement, ou en tous les cas de manière différenciée se
lon la peine concrètement encourue, la notion de
«mesures
d’instruction hors de proportion avec la peine encourue»
.
En effet, les normes renvoyant à l’art. 7 DPA sont toujours
plus nombreuses et, surtout, elles augmentent pour certai
nes considérablement le plafond de 5000 francs prévu par
le législateur de 1974 (100000 francs pour l’art. 87 LTVA,
par exemple). Or, on ne saurait à l’évidence considérer com
me un cas bagatelle celui que vient sanctionner une amen
de de cette importance, dont le caractère pénal (selon les cri
tères de la jurisprudence de la CEDH) est indiscutable.
On doit donc retenir que, tendanciellement, les condi
tions d’application de l’art. 7 DPA se rapprochent de celles,
plus restrictives, de l’art. 102 al. 1 CP.
Les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité pé
nale (ou administrative pénale) de l’entreprise qui en résul
te pose un certain nombre de problèmes. L’un des arguments
soulevé par l’administration à l’appui de son recours le dé
montre. L’administration a en effet mis en avant le fait que
la personne physique qui pourrait être recherchée selon l’art.
6 DPA n’est parfois pas l’unique, ni même le principal res
ponsable de l’infraction commise. En affirmant cela, l’OFT
indique qu’elle n’envisage pas (ou plus?) seulement l’art. 7
DPA comme une norme d’opportunité, facilitant la pour
suite et le prononcé d’une sanction. En ce sens également,
la pratique marque peut-être une évolution. Cette percep
tion de l’administration traduit la prise de conscience d’une
réalité, la dilution des mécanismes de décision et d’action














