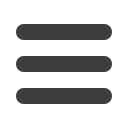

111
RECHTSPRECHUNG
2/2008
forum
poenale
au sein des entreprises, qui est précisément l’une des raisons
majeures ayant conduit à l’adoption d’une responsabilité
pénale de l’entreprise: punir l’individu revient parfois à se
tromper de cible.
De ce point de vue, les conditions de mise en œuvre de
l’art. 7 DPA (mais la disposition n’avait pas été pensée pour
cela), et plus encore celles de la responsabilité subsidiaire ins
taurée à l’art. 102 al. 1 CP, sont trop restrictives pour assu
rer une réelle efficacité à ces normes. Ces dispositions gagne
raient ainsi en clarté et en efficacité en s’inspirant de la
responsabilité primaire de l’entreprise dont dispose l’art. 102
al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, la responsabilité
pénale de l’entreprise peut être recherchée, indépendamment
de la punissabilité d’une personne physique, s’il doit lui être
reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisa
tion raisonnables et nécessaires qui eussent pu
empêcher
l’in
fraction. La disposition ne peut toutefois être mise en oeuvre
qu’à l’occasion de la commission d’un certain nombre d’in
fractions exhaustivement énumérées à l’art. 102 al. 2 CP. Ce
catalogue exhaustif d’infractions, lesquelles permettent donc
seules d’engager la responsabilité primaire de l’entreprise,
est d’ailleurs appelé à être étendu. Il l’a été dès avant l’entrée
en vigueur de la norme le 1
er
octobre 2003 par l’adjonction
de l’art. 260
quinquies
CP (financement du terrorisme). Il l’a été
ensuite, au 1er juillet 2006, par l’adjonction de l’art. 4a al.
1 let. a LCD. D’autres infractions viendront encore complé
ter la liste des crimes et des délits susceptibles d’engager la
responsabilité primaire de l’entreprise. La tendance en la ma
tière est sans doute celle qui a présidé à l’évolution du droit
français: en France, la responsabilité pénale des personnes
morales avait aussi était conçue au départ comme limitée
aux seules infractions prévoyant expressément leur imputa
bilité à ces personnes morales. Après une extension du cata
logue des infractions imputables, le législateur français a fi
nalement décidé, en 2000, de faire de la responsabilité
pénale des personnes morales une forme générale d’imputa
tion, quelles que soient les infractions concernées.
III. Enfin, un point mérite d’être précisé s’agissant de la
relation entre l’art. 7 DPA et l’art. 102 al. 2 CP. Depuis le
1
er
juillet 2006, la corruption active dans le secteur privé se
lon l’art. 4a al. 1 let. a LCD est donc incluse dans la liste
des infractions permettant d’engager la responsabilité pri
maire de l’entreprise. Or, la répression des infractions (dé
lictuelles) à l’art. 4a al. 1 let. a LCD commises dans une en
treprise relève en principe, en raison du renvoi de l’art. 26
LCD, des art. 6 et 7 DPA.
Il n’existe cependant pas de choix possible entre la res
ponsabilité primaire de l’art. 102 al. 2 CP et l’art. 7 DPA.
Malgré le renvoi de l’art. 26 LCD, l’art. 7 DPA ne trouve
ra jamais à s’appliquer s’agissant de la commission d’un acte
de corruption privée active intervenu au sein d’une entre
prise aux conditions de l’art. 102 al. 2 CP. En effet, la res
ponsabilité primaire de l’entreprise selon l’art. 102 al. 2 CP
est
indépendante
de la punissabilité des personnes physi
ques. Dès lors, l’entreprise peut être recherchée pénalement
pour une violation de l’art. 4a al. 1 let. a LCD même si
l’auteur individuel de l’infraction est identifié selon l’art. 6
al. 1 DPA. Or, l’art. 7 DPA n’entre en ligne de compte que
si l’infraction n’est pas imputée à une personne physique se
lon l’art. 6 DPA (al. 1, 2 ou 3). En d’autres termes, l’indé
pendance de la punissabilité de l’entreprise consacrée à l’art.
102 al. 2 CP est totalement étrangère au mécanisme de l’art.
7 DPA. On doit par conséquent retenir que le DPA ne
contient pas de disposition sur la matière traitée par l’art.
102 al. 2 CP au sens des art. 333 al. 1 CP et 2 DPA, ce qui
exclut l’application de la norme pénale administrative.
Dr. Alain Macaluso, Chargé de Cours à l’Université de
Fribourg, Avocat au Barreau de Genève
n
7. Internationale Rechtshilfe
Entraide judiciaire internationale
Nr. 30
Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung,
Urteil vom 23. Januar 2007 i.S. X. gegen Bundes-
amt für Justiz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) –
1A.181/2006/1A.211/2006, BGE 133 IV 76 (aus-
schnittsweiser Abdruck)
Art. 51 Ziff. 4 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Konven
tionen; Art. 2 Ziff. 1, Art. 10, 12 Ziff. 2 lit. b und Art. 14 Ziff. 1
EAUe; Art. 7 und 10 Ziff. 1 UNO-Pakt II; Art. 3 EMRK; Art. 10 Abs.
3 und Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 24 und 111 StGB: Auslieferung; Ver-
folgung eines mutmasslichen Führungsmitglieds der PKK durch
die Türkei.
Anforderungen an das Auslieferungsersuchen; Vorwürfe gegen den
Verfolgten laut Ersuchen; beidseitige Strafbarkeit bejaht im Hin
blick auf die untersuchte Teilnahme an der Tötung eines sogenann
ten «Dorfwächters» (E.2). Einrede des politischen Deliktes. Mit
berücksichtigung der bürgerkriegsähnlichen Situation imZeitpunkt
der verfolgten Straftat. Problematische Abgrenzung zwischen Ter
rorismus und legitimem Widerstandskampf gegen ethnische Ver
folgung und Unterdrückung. Terroristischer Charakter nament
lich von schweren Gewalttaten, die unterschiedslos auch
Unbeteiligte bzw. Zivilisten treffen (E.3.8 und 3.9). Anforderun
gen an ausreichende Menschenrechtsgarantien des ersuchenden
Staates in Auslieferungsfällen wie dem vorliegenden (E.4). (Reges
te des Gerichts)
Art. 51 ch. 4 du Protocole additionnel I aux Conventions de
Genève; art. 2 par. 1, art. 10, 12 par. 2 let. b et art. 14 par.
1 CEExtr; art. 7 et 10 par. 1 Pacte ONU II; art. 3 CEDH; art. 10 al.
3 et art. 25 al. 3 Cst.; art. 24 et 111 CP: extradition; poursuite par
la Turquie d’un membre dirigeant présumé du PKK.














