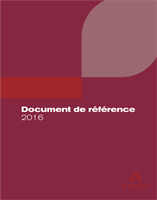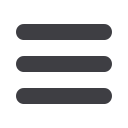

APERÇU DES ACTIVITÉS
06
6.1 Les marchés de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables
6.1.
LES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
6.1.1.
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE CONTEXTE
ÉNERGÉTIQUE MONDIAL
6.1.1.1.
LES DÉFIS DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
Des besoins en électricité en forte croissance
La croissance économique mondiale est relativement stable, en légère
augmentation depuis 2012 (environ 2,4 % par an, Banque Mondiale), mais inégale
selon les régions. Cependant, la demande globale en énergie a continué de croître,
y compris dans les pays industrialisés. Plusieurs indicateurs macroéconomiques
laissent penser que la croissance économique des pays industrialisés restera faible
à moyen terme, celle des pays émergents continuant en revanche de progresser
et représentant à ce titre le plus important gisement de croissance pour le secteur
de l’énergie.
Dans l’ensemble, les besoins mondiaux d’énergie sont voués à augmenter, tirés
par la croissance démographique, l’accès du plus grand nombre à l’énergie et la
croissance économique de long terme.
Selon le scénario central Scénario Politiques Nouvelles
(1)
du
World Energy Outlook
(WEO) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publié en novembre 2016, la
consommation mondiale d’énergie primaire, de 13,684 Gtep (tonnes équivalent
pétrole) en 2013, devrait atteindre 17,9 Gtep en 2040, soit une croissancemoyenne
de 1 % par an. Ce sont la Chine et l’Inde, les pays émergents et les pays en voie
de développement qui devraient être à l’origine de la majorité de la demande
supplémentaire.
La consommationmondiale d’électricité a connu une croissance un peu supérieure
à la consommation globale d’énergie primaire, de 3,2 % en moyenne de 2000
à 2014. Dans le scénario central de l’AIE, la production électriquemondiale en 2040
est estimée à 34 250 TWh, contre 20 557 TWh en 2014, soit une croissance
annuelle moyenne de 2 %. La quasi-totalité de cette croissance est portée par les
pays non-membres de l’OCDE. Néanmoins en Chine, la consommation d’électricité
qui a bondi entre 2000 et 2014 avec un taux moyen de croissance de presque
11 % par an devrait subir un fort ralentissement dans les années à venir avec un
taux de croissance moyen de 2,4 % par an de 2014 à 2040.
Du côté de l’offre, pétrole, gaz et charbon constituent encore aujourd’hui les sources
d’énergie privilégiées. En 2014, le pétrole constituait 31,3 % de l’énergie primaire
mondiale, le charbon 28,6 % et le gaz naturel 21,2 %. Les productions pétrolière
et gazière aux États-Unis mettent en œuvre à grande échelle des technologies
permettant l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz de schiste. Toutefois,
la production de gaz non conventionnel par fracturation hydraulique fait l’objet de
préoccupations environnementales. Les politiques énergétiques mises en œuvre
dans plusieurs pays cherchent à infléchir cette tendance. Les objectifs de lutte
contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la question de la sécurité
d’approvisionnement en énergies fossiles se sont en effet imposés parmi les
préoccupations des populations, des industriels et des gouvernements. Ceux-ci
mettent en place des mesures d’économies d’énergie, des politiques de promotion
des énergies renouvelables et de diversification de leur portefeuille de technologies
énergétiques. De nombreux pays envisagent actuellement la possibilité d’utiliser
l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables, et/ou d’en accroître leur part
pour augmenter leur sécurité d’approvisionnement énergétique, améliorer leur
compétitivité et la prévisibilité de leurs coûts, et réduire leurs émissions de CO
2
,
afin d’assurer une croissance économique durable.
Énergie et réchauffement climatique
Les Accords de la Convention Cadre des Nations Unies
Depuis la création de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à Rio en 1990, le réchauffement climatique fait l’objet d’une implication
des gouvernements à l’échellemondiale. L’objectif est la limitation de l’augmentation
moyenne de la température sur terre à + 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Une
réunion de l’ensemble des gouvernements, la Conférence des Parties (COP), se
tient chaque fin d’année dans un pays différent. Un premier accord d’envergure
a été établi en 1997 au Japon par la signature du protocole de Kyoto entre pays
historiquement industrialisés pour une réduction des émissions de GES à réaliser
sur la période 2008-2012.
Le deuxième Accord connu sous le nom d’Accord de Paris a été signé lors de la
COP21 en décembre 2015 à Paris. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016
ayant été ratifié par plus de 100 pays totalisant près de 75 % des émissions de
gaz à effet de serre. Ce nouvel accord implique les pays développés et les pays en
développement. Il demande de s’efforcer de limiter l’augmentation moyenne de
température à 1,5 °C, ce qui en réduit significativement des risques et les impacts.
À la demande de la convention, le GIEC publiera en 2018 un rapport précisant le
niveau d’émissions pour cet objectif ultime.
L’atteinte de l’objectif de l’accord de Paris se fera principalement grâce au
mécanisme des « NDCs » (
Nationally Determined Contribution
) transmis par chaque
partie, qui précise les intentions de réduction d’émissions prisent dans le secteur
énergétique. À ce jour 189 pays couvrant 98,8%des émissions mondiales de gaz à
effet de serre ont soumis leurs contributions. L’accord de Paris prévoit une révision
tous les 5 ans des intentions de réduction des États ainsi qu’une augmentation
de la capacité d’adaptation au changement climatique et la mise à disposition
d’un fonds vert, mis en place en 2009 lors de la conférence de Copenhague, doté
en 2014 de moyens financiers à hauteur de 7,4 milliards d’euros grâce à l’apport
des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France. Une
valeur plancher de 100 milliards de dollars annuels d’ici 2020 est prévue, pour
soutenir l’adaptation au changement climatique des pays les plus vulnérables et
soutenir les projets d’investissement bas carbone. L’accord encourage également
les sources de financement bilatérales et multilatérales, publiques et privées, déjà
créées comme le
Green Climate Fund
et le
Global Environmental Facility
.
(1) Le Scénario Politiques Nouvelles de l’AIE intègre, en plus des politiques et mesures déjà décidées nationalement à mi-2015, les déclarations de réduction des gaz à effet de serre
communiquées à la Convention cadre sur le Changement Climatique : d’autres réductions devraient être nécessaires afin de limiter l’impact du changement climatique à une
augmentation de la température de 2 °C. Développés dans le « Scénario 450 », de tels efforts nécessiteraient de nouvelles structures nucléaires et d’énergies renouvelables dans
le monde.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
43