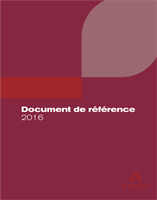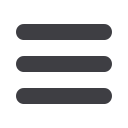

APERÇU DES ACTIVITÉS
06
6.1 Les marchés de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables
à la chute d’un avion gros porteur) tel que confirmé par la certification des
autorités de sûreté ainsi que les dispositions nécessaires à la continuité du
refroidissement ;
p
compétitivité : réduction de la consommation de combustible et des coûts
d’exploitation, disponibilité élevée de 92% sur une durée d’exploitation de 60 ans
pour une production maximum d’électricité ;
p
environnement : réduction de la quantité de combustible usé et de déchets
ultimes.
6.1.1.3.
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables participent elles aussi à l’augmentation de
l’indépendance énergétique vis-à-vis des ressources fossiles tout en limitant les
émissions de gaz à effet de serre.
Elles bénéficient aujourd’hui de dispositifs de soutien dans de nombreux pays : tarifs
d’achat de l’électricité, quotas de production, certificats verts, etc. L’engagement
de nombreux pays à développer la part des énergies renouvelables dans leur
production laisse supposer que de telles politiques seront poursuivies.
La compétitivité de certaines technologies renouvelables est déjà dans certaines
zones en ligne avec celle des sources d’énergies classiques, notamment grâce aux
améliorations technologiques, aux économies d’échelle, aux effets d’apprentissage
et à la taille croissante des installations. Par ailleurs, la consolidation accélérée
observée au sein de nombreuses filières de ce marché devrait contribuer à
l’accroissement à court terme de cette compétitivité.
6.1.2.
MARCHÉS DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Les premiers programmes industriels nucléaires de production d’électricité ont
débuté au milieu des années 1960 aux États-Unis et au début des années 1970 en
Europe. Les craintes d’une raréfaction des énergies fossiles (choc pétrolier) dans les
années 1970 et la volonté d’un certain nombre d’États de réduire leur dépendance
énergétique ont conduit ces derniers à se lancer dans le développement du
nucléaire. Les années 1970 et 1980 ont ainsi connu une fortemontée en puissance
de ces programmes comme l’illustre le schéma ci-dessous. Cette forte croissance
s’est ralentie avec les craintes de l’opinion publique à la suite des accidents de
Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986. Ainsi, si 399 réacteurs ont été
construits sur la période 1970-1990, la capacité installée n’a crû que de 22,9 % sur
la période 1990-2016. Le développement du parc en Europe de l’Est et en Asie a
pris le relais des vastes programmes initiés à l’origine en Amérique du Nord et en
Europe occidentale. Suite au tsunami japonais enmars 2011 ayant causé l’accident
de Fukushima, le parc installé a renforcé sa sécurité d’approvisionnement en eau
de refroidissement en conditions accidentelles et a mis en place de nouvelles
mesures de sûreté pour faire face à de tels événements.
ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ ÉLECTRONUCLÉAIRE MONDIALE INSTALLÉE (EN GWE NET)
Europe occidentale
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Capacité nette (GWe)
Année
Europe centrale et orientale
Asie – Moyen-Orient et Méridionale
Asie – Extrême-Orient
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2016
2010
Source :AIEA, système de documentation sur les réacteurs de puissance.
La capacité électronucléaire mondiale installée en 2016 est estimée à 391 GWe,
en légère progression par rapport à 2015.
Le schéma ci-contre montre la répartition de la capacité électronucléaire mondiale
installée :
Au 31 décembre 2016, 449 réacteurs représentant 412 GWe (391 GWe nets)
étaient en service, répartis dans 31 pays parmi lesquels les principaux foyers de
consommation d’énergie dans le monde.
La base installée en Europe et dans les pays de la Communauté des États
Indépendants (CEI) reste prééminente (environ 41 % du parc mondial) devant
l’Amérique du Nord (26 % du parc). Cependant, c’est dans les pays asiatiques
(Chine, Corée du Sud et Inde) et dans une moindre mesure dans les pays de la CEI
que se situe l’essentiel du potentiel de croissance à moyen terme (horizon 2017-
2018) du parc électronucléaire, comme illustré dans le schéma ci-après.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
49