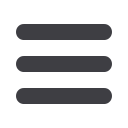

14
Le malaise m’envahit.
J’allai tout de suite trouver Françoise, qui me reçut avec une froideur déterminée,
se montrant offensée de mon insistance, et refusant de me fournir la moindre
explication. Sa porte se fermait et, par là même, c’est l’accès à Mère qui me
devenait interdit.
Quelques jours s’écoulèrent dans une sorte de stupéfaction, une brûlure qui
m’étreignait.
Il m’était récemment arrivé à plusieurs reprises que quelqu’un que je connaissais à
peine tente de m’avertir ; ce fut une fois une jeune femme, mère de l’un des
premiers enfants nés à Auroville, qui m’interpella pour me mettre en garde, me
disant qu’on cherchait à me jouer un mauvais tour.
Au cours des années précédentes, on m’avait souvent défini alternativement
comme un ange ou un diable, et j’avais tendance à en prendre, sans en
comprendre clairement les termes, la responsabilité ; avec elle venait un sentiment
de culpabilité que tantôt je rejetais, qui tantôt m’étouffait.
J’étais conscient que ma présence ne laissait guère indifférent, il y avait là trop
d’intensité, mais je ne me connaissais aucune mauvaise volonté.
Je me sentais surtout trop aveugle, trop ignorant, trop divisé entre mes désirs et
mon aspiration, le désespoir et le besoin de servir.
Et là, je n’avais pas la moindre compréhension de ce qui se passait, de la cause ou
des causes de cette obstruction, de ce rejet.
S’il m’était possible de deviner le rôle de jalousies ou de dépits personnels, je ne
pouvais pas saisir en quoi cela pourrait influer sur la décision de Mère.
Je me sentais comme un condamné que l’on aurait jugé à son insu.
Un soir, alors que je me tenais debout à mon poste habituel près du Samadhi de Sri
Aurobindo, Paola s’approcha de moi et demanda à me parler. Je savais seulement
d’elle qu’elle était la mère d’Aurofilio, un tout petit enfant, le premier d’Auroville je
crois, dont j’aimais toujours rencontrer le radieux sourire et la reconnaissance
immédiate du regard. Elle me dit qu’elle travaillait comme secrétaire pour Nata, qui
était lui-même un intermédiaire auprès de Mère, principalement pour les Italiens ;
et que Nata l’avait chargée de me dire qu’il m’avait observé et qu’il était touché par
ma sincérité et triste de ce qui venait de m’arriver, et qu’il s’offrait ainsi que sa
compagne Maggi, elle-même l’une des secrétaires de Mère, à remettre à Mère mes
lettres et mes questions si je le souhaitais.
C’est ainsi que je rencontrai Nata et Maggi, chez eux.
Ils ne purent, ou ne voulurent, rien m’expliquer non plus. Mais leur bonne volonté
était tangible, et c’était pour moi le sauvetage.
Je ne voulais pas déranger Mère. Nous savions tous combien, parfois, Elle peinait,
là-haut, dans Sa chambre, même si nous ne pouvions mesurer l’ampleur et la
portée de Son travail, et ne soupçonnions pas l’horreur de ce qu’Elle devait parfois
seule affronter.
Maggi et moi convînmes que, si Mère en avait le temps à la prochaine entrevue
qu’elle aurait avec Elle, Maggi Lui demanderait simplement de dire ce que je devais
faire.
A cette période, Mère demeurait le plus souvent en transe – du moins c’est ainsi
que les uns et les autres choisissaient de définir l’état de concentration dans lequel
Mère était de plus en plus plongée.


















