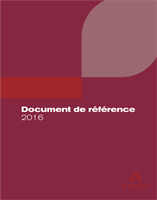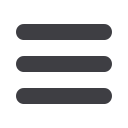

FACTEURS DE RISQUES
04
4.4 Risques industriels et environnementaux
4.4.1.
RISQUES NUCLÉAIRES
4.4.1.1.
RISQUES D’ORIGINE NUCLÉAIRE
Les risques d’origine nucléaire sont liés aux caractéristiques des substances
radioactives. Ils concernent donc toutes les installations industrielles du groupe où
se trouvent ces substances, qu’il s’agisse d’INB, d’INBS, d’ICPE ou d’exploitations
minières.
La prévention des risques est basée sur une analyse systémique et systématique
des risques spécifiques à chaque installation ou activité exercée et sur la définition
de moyens de prévention des événements redoutés, de détection, de maîtrise des
incidents et des accidents et de limitation de leurs conséquences potentielles, sur la
base des principes de la défense en profondeur. Ces principes consistent à analyser
systématiquement les défaillances techniques, humaines ou organisationnelles
potentielles, et à définir et mettre en place des lignes de défense successives et
indépendantes pour se prémunir des conséquences de ces défaillances.
Ces principes sont mis enœuvre dès la conception des installations, lors des phases
de production industrielle et des opérations d’assainissement et de démantèlement
consécutives à l’arrêt des activités de production.
Dissémination de matières radioactives pouvant entraîner
une contamination
Des matières radioactives (solides, liquides, gazeuses) peuvent se disperser
et entraîner une contamination de l’homme et de l’environnement si elles sont
insuffisamment confinées. Maîtriser ce risque consiste avant tout à limiter la
dispersion de ces substances dans toutes les situations de fonctionnement (normale
ou accidentelle) des installations, ainsi qu’après l’arrêt d’activité, notamment par
l’interposition de barrière de confinement et de systèmes de ventilation adaptés.
Les rayonnements ionisants
Il y a risque d’exposition aux rayonnements ionisants chaque fois qu’une personne
se trouve en situation de travailler en présence de matières radioactives.
L’évaluation de l’impact biologique d’un rayonnement sur le corps humain s’exprime
généralement en millisievert (mSv). Les limites réglementaires annuelles sont les
suivantes :
p
dans l’Union européenne, 1 mSv/an pour le public en supplément de la
radioactivité naturelle, et 100mSv pour les salariés sur cinq années consécutives,
à condition de ne pas dépasser 50 mSv sur une année quelconque ;
p
aux États-Unis, 1 mSv/an pour le public et 50 mSv/an pour les salariés ;
p
en France, la limite réglementaire maximale pour les salariés est de 20 mSv/
an. AREVA a repris à son compte cette limite maximale pour l’ensemble de son
personnel et de ses sous-traitants, sur l’ensemble de ses installations et activités,
quel que soit le pays où elles se trouvent.
Des dispositifs de protection et de surveillance collectifs sont installés pour atténuer
les rayonnements à la source et optimiser les doses reçues à des niveaux aussi
bas que raisonnablement possible. En complément et si nécessaire, le temps de
présence des opérateurs est limité. Le groupe applique le principe « ALARA » (
As
Low As Reasonably Achievable
– « Aussi faible que raisonnablement possible »),
selon lequel toute action permettant de réduire l’exposition aux rayonnements
est mise en œuvre dès lors qu’elle est raisonnable des points de vue technique,
économique, social et organisationnel. Les différents services de radioprotection
s’assurent en permanence du respect de ce principe d’optimisation.
Tous les opérateurs et intervenants classés au titre de la radioprotection, après
étude de poste et accord du médecin du travail, font l’objet d’un suivi médical et
radiologique rigoureux. Des séances de formation sont régulièrement organisées
afin de maintenir leurs connaissances au niveau approprié, conformément à la
réglementation applicable.
Les résultats enregistrés (voir Annexe 3.
Responsabilité sociale environnementale
et sociétale
) attestent de l’efficacité de ces pratiques et du bon niveau de maîtrise
de la radioprotection dans le groupe.
La criticité
Le risque d’accident de criticité correspond au risque de développement incontrôlé
d’une réaction en chaîne avec émission brève et intense de neutrons, accompagnée
de rayonnements. Cet accident aurait pour conséquence une irradiation des
personnes situées à proximité de l’événement, engendrant chez elles des lésions
de gravité proportionnelle à l’intensité du rayonnement reçu. Ce risque est pris en
compte dès lors que les installations sont susceptibles de recevoir des matières
fissiles.
La prévention de ce risque est fondée sur la limitation des paramètres qui
gouvernent l’apparition de réactions en chaîne divergentes. Ceci est pris en
compte à la conception (par exemple
via
la géométrie des équipements) ou par
des prescriptions opératoires : limitation demasse à titre d’exemple. Cette démarche
de prévention est complétée dans les parties les plus exposées au risque des
installations par la présence d’écrans de protection qui atténuent très fortement les
conséquences sur le personnel d’un incident de criticité éventuel, et l’installation
d’un réseau de détection, d’alarme et de mesure d’accident de criticité.
La sûreté-criticité des transports est vérifiée, dans les conditions normales et dans
les conditions accidentelles. Les règlements de transports précisent les règles
d’entreposage en transit, notamment vis-à-vis du risque de criticité.
Les dégagements thermiques et la radiolyse
Lorsque le rayonnement est intense, l’énergie associée, absorbée par la matière,
peut provoquer un échauffement. Pour maîtriser les effets de cet échauffement,
l’énergie produite est évacuée, empêchant ainsi une dispersion de matières
radioactives. Le refroidissement est assuré par des circuits redondants avec
échangeurs thermiques et par la ventilation.
Le phénomène de radiolyse correspond lui à la décomposition d’un composé
hydrogéné (l’eau tout particulièrement) sous l’action d’un rayonnement, conduisant
au dégagement d’hydrogène. Les installations sont conçues pour limiter en
fonctionnement normal la concentration en hydrogène par introduction dans les
équipements concernés d’un flux d’air de balayage. Lorsque la perte du balayage
normal conduit à une montée de la concentration jusqu’à la valeur limite en
quelques heures ou dizaines d’heures, un système de secours est ajouté.
4.4.1.2.
RISQUES INTERNES POUVANT ENTRAÎNER UN
RISQUE NUCLÉAIRE
Il existe aussi, comme dans toute activité industrielle, des risques liés au
fonctionnement des installations et à la présence de personnel. Dans l’industrie
nucléaire, la prévention de ces risques est importante, car ils sont de nature à affecter
les équipements participant à la maîtrise de la sûreté. La prévention est basée
sur la prise en compte par conception ou par consignes opératoires des causes
potentielles de dysfonctionnements, et sur la limitation de leurs conséquences
éventuelles.
Les risques classiques le plus souvent rencontrés sont :
p
les risques liés à la manutention et à l’usage d’appareils de levage, de transport
ou de positionnement ;
p
les risques d’incendie et d’explosion interne ;
p
les risques liés à l’usage de réactifs chimiques ou dematières premières toxiques
comme l’HF ou l’UF
6
;
22
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016