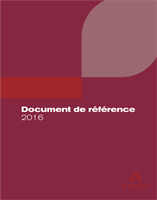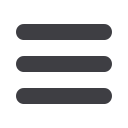

FACTEURS DE RISQUES
04
4.4 Risques industriels et environnementaux
Ce sont :
p
la protection physique pour prévenir, détecter, empêcher ou retarder tout accès
non autorisé aux matières nucléaires ou tout acte de sabotage pouvant conduire
à une mise en danger de la population ;
p
le suivi physique qui vise à autoriser les mouvements de matières nucléaires
et à les contrôler ;
p
la comptabilitématière, indépendante du suivi physique et qui permet un contrôle
indépendant fondé sur la connaissance quotidienne des quantités de matières
détenues dans toutes les zones de l’établissement et de tous les mouvements
de matières nucléaires entre ces zones.
La conformité des mesures prises et leur application sont régulièrement contrôlées
par les autorités compétentes et, notamment en France, par les inspecteurs du
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer.
4.4.1.7.
NON-PROLIFÉRATION
La prolifération s’entend comme le détournement de matière nucléaire par un État
à des fins non pacifiques.
La non-prolifération est un objectif commun à l’ensemble des États signataires
des conventions internationales correspondantes (notamment le traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires du 1
er
juillet 1968). Les exigences applicables au
titre de la non-prolifération relèvent de la protection physique desmatières nucléaires
(voir la Convention internationale sur la protection physique desmatières nucléaires),
du contrôle de sécurité prévu par le traité Euratom qui instaure un système de
comptabilité des matières nucléaires, et des inspections de l’AIEA et d’Euratom.
Afin de répondre aux exigences de la réglementation nationale pour la protection et
le contrôle des matières nucléaires et des installations, AREVAmet en œuvre dans
ce domaine toutes les dispositions visant à connaître en permanence la quantité, la
qualité, l’usage et la localisation des matières détenues par les entités du groupe.
4.4.1.8
RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE
Les entités juridiques du groupe, ayant la qualité d’exploitant d’installations
nucléaires de base (INB) et d’installations industrielles relevant de la législation
sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ont
l’obligation de procéder, lors de l’arrêt définitif d’activité de tout ou partie de ces
installations, à leur mise en sécurité, à leur démantèlement ou à la remise en état
des sites, et à la gestion des produits issus de ces opérations. De même, la qualité
d’exploitant des mines d’uranium comporte les obligations d’assurer des travaux
de fermeture, de mise en sécurité et de réaménagement des mines après leur
exploitation.
Le groupe anticipe les opérations de démantèlement de ses nouvelles installations,
en les prévoyant dès la conception. La sûreté des opérations de démantèlement
bénéficie du retour d’expérience de la maintenance des installations avec laquelle
elles présentent des similitudes, des activités de démantèlement réalisées pour
son propre compte ou pour celui d’autres exploitants nucléaires, ainsi que
de celui de chantiers pilotes réalisés en amont. Des outils ont été développés
pour faciliter l’adoption de nouveaux standards de traçabilité et permettre ainsi
de réduire les investigations nécessaires aux caractérisations de l’état de fin
d’exploitation (radiologique, physico-chimique…), ainsi que les impacts des travaux
de démantèlement.
En France, la loi prévoit un mécanisme permettant d’assurer que les exploitants
d’INB disposent des actifs nécessaires au financement des charges de long terme
découlant du démantèlement de ces installations ou de la gestion des combustibles
usés ou des déchets radioactifs. Aux États-Unis le
Decomissioning Funding Plan
(DFP) est mis à jour tous les trois ans.
Les dépenses futures associées aux obligations de fin de cycle des installations
nucléaires et à la remise en état des installations industrielles classées sont
identifiées, et des provisions spécifiques sont constituées par les entités juridiques
exploitantes desdites installations. Les règles relatives aux provisions pour opérations
de fin de cycle sont détaillées à Section 20.2.
Annexe aux comptes consolidés
,
Note 13.
Opérations de fin de cycle
. Les provisions de fin de cycle s’élevaient à
7 172 millions d’euros au 31 décembre 2016, en valeur actualisée ; le montant
de la valeur de marché des actifs dédiés s’élevait à 6 357 millions d’euros à cette
même date, soit un ratio de couverture de 89 %.
Le provisionnement des dépenses de fin de cycle se fait sur la base d’estimations de
coûts futurs réalisées par le groupe qui sont, par nature, fondées sur des hypothèses
(voir la Section 20.2.
Annexe aux comptes consolidés,
Note 13.
Opérations de
fin de cycle
). Il ne peut cependant être affirmé avec certitude que les montants
actuellement provisionnés seront en phase avec les coûts effectifs finalement
supportés par le groupe qui pourraient être plus élevés que ceux initialement
prévus, en raison notamment de l’évolution des lois et règlements applicables aux
activités nucléaires et à la protection de l’environnement, de leur interprétation par
les tribunaux, et de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces
coûts dépendent également des décisions prises par les autorités compétentes
relatives notamment aux conditions du démantèlement et à l’adoption de solutions
pour le stockage final de certains déchets radioactifs ainsi que du coût définitif
de ces solutions (voir la Section 20.2.
Annexe aux comptes consolidés,
Note 13.
Opérations de fin de cycle
). Il est à ce titre possible que ces futures obligations et
les éventuelles dépenses ou responsabilités complémentaires de nature nucléaire
ou environnementale que le groupe pourrait avoir ultérieurement à supporter aient
un impact négatif significatif sur sa situation financière.
Les principaux risques disruptifs susceptibles d’impacter sensiblement le coût des
passifs de fin de cycle portent sur :
p
les écarts entre l’état initial envisagé des installations anciennes et des déchets
historiques et leur état réel constatable lors des premières investigations
opérationnelles dans les installations ;
p
des évolutions de la réglementation ou de la doctrine, notamment en matière
d’état final visé des installations et des sols après le démantèlement ou de
requalification en déchets de matières radioactives actuellement encore
considérées comme valorisables ;
p
l’augmentation sensible des coûts de conditionnement et de stockage des
déchets radioactifs, notamment ceux destinés au stockage profond (coût du
stockage futur Cigéo) et ceux ne disposant pas encore de filière définitive.
Afin de faire face aux obligations futures de fin de cycle, le groupe dispose d’un
portefeuille d’actifs financiers (actions, obligations, fonds communs de placement et
créances à recevoir de tiers). Le ratio de couverture des passifs de fin de cycle par les
actifs dédiés étant inférieur à 100%au 31 décembre 2016, le groupe fait aujourd’hui
l’hypothèse d’un abondement au fonds dédié de l’ordre de 800 millions d’euros
en 2017 afin de revenir à un taux de couverture de 100 % en 2017, notamment
grâce à l’augmentation de capital annoncée. L’atteinte du taux de couverture de
100 % dépendra également des conditions de marché, qui ne peuvent pas être
anticipées (taux d’actualisation et rendement du fonds dédié constaté à fin 2017).
Toutefois, et malgré la stratégie de gestion prudente des actifs dédiés par le groupe,
des facteurs économiques exogènes peuvent impacter défavorablement le ratio
de couverture des passifs de fin de cycle par les actifs dédiés, et donc la situation
financière du groupe, tels que :
p
le comportement défavorable des marchés financiers qui fait peser un risque
de rendement inférieur des actifs par rapport aux hypothèses, en particulier,
en raison du risque de volatilité inhérent aux marchés des capitaux, la valeur
du portefeuille de titres financiers pourrait diminuer et/ou offrir un rendement
inférieur à celui nécessaire pour assurer à terme la couverture des charges liées
aux obligations de fin de cycle ;
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
25