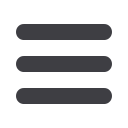

1164
habitâmes pendant plus de 4 ans dans un pavillon délabré, situé dans un parc à
demi abandonné à l’orée du bois de Clamart. Ce pavillon et quelques autres
pavillons voisins abritaient plusieurs familles pauvres.
Notre richesse était celle de nos amis, des liens que C et F.J avaient formés parmi
les intellectuels, les artistes, les engagés ; F.J était devenu l’absent renommé, le
combattant clandestin, le chef de réseau, l’intellectuel d’action.
Mes amis les plus proches, dont l’existence avait un sens affectif privé et intime,
étaient deux. Elle, c’était Laurence, dont le père était Indochinois à la beauté
austère, et la mère Belge, je crois, une rousse flamboyante ; Laurence avait les
traits asiatiques et la chevelure d’ébène de son père, tandis que sa sœur
ressemblait à sa mère. Lui, c’était Jean-Guy, dont l’un des parents était Arabe – je
ne me souviens plus duquel car, pour quelque raison, je n’allais que rarement chez
eux.
Ils étaient tous deux plus âgés que moi ; ainsi ils n’étaient pas mes compagnons
d’école. A l’école je ne rencontrais rien qu’une routine apparemment inévitable, à
l’exception d’une maîtresse que j’adorais comme on adore une déesse – les effluves
du drame de sa vie comme d’un mythe, sa silhouette ceinte d’un manteau de
léopard s’avançant vers l’automobile où l’attendait un homme, son automobile et
son homme et son mystère.
Ils étaient mes compagnons de vie : des heures libres, des bois, des cabanes et des
escapades et des déguisements, des émotions soudain débusquées.
Dans la frange encore multidimensionnelle du monde adulte, ils étaient près de moi
un peu plus définis que je ne l’étais encore. Les jeux d’enfant ne m’attiraient pas.
Les adultes, les amis de C et F.J, les femmes du réseau plus ou moins toutes
éprises de lui, trouvaient en moi une écoute inattendue et me traitaient avec une
sorte de déférence affectueuse mais intimidée qui leur permettait, quand le besoin
s’en faisait sentir, de me faire aussi leurs confidences.
J’aimais les voitures, j’aimais conduire, et je n’avais pas 10 ans que C me laissait
déjà m’installer au volant de sa vieille 2 CV Citroën et la déplacer dans les allées du
parc.
Des jeux de poupées que jouaient les filles, je retenais l’attrait du déguisement et
m’identifiais facilement à ce mouvement d’émulation féminine où l’on se revêt des
attraits que l’on ne mérite pas encore ; je faisais là l’apprentissage de ma propre
féminité, et pourtant la relation intérieure entre Laurence et moi était d’un autre
ordre : elle aurait pu devenir ma compagne, et l’aurait sûrement souhaité, si les
circonstances l’avaient favorisé. Elle était seulement, dans ces moments de frénésie
ramassée, inarticulée, qu prélude à l’éveil d’une sexualité individuelle, une complice
avec sa sœur d’un émoi partagé, incertain, à peine déterminé.
Jean-Guy recevait de moi les premières expressions retenues d’une émotion qui ne
me quittera plus, quelles que soient ses formes et ses incidences successives :
l’émotion envers sa beauté, sa vulnérabilité fière et masculine, le sens d’un corps
tout entier, dans sa solitude, animé, parcouru, nourri d’une sexualité latente qui est
elle-même émotion, une émotion incarnée, devenue physique, matérielle, devenue
visage et nom et caractère uniques, le détail bouleversant d’un geste, d’un seul
geste, le pli d’un vêtement sur le corps, la courbe tendre du cou, le bord d’une
lèvre, une présence comme une onde faite forme précise, condensée.
Laurence était l’énigme tranquille, aux étendues recélées, le noir éclatant de sa
chevelure sur la pâleur cendrée de son visage comme une immensité en un point,
le regard plus secret qui coulait de ses yeux d’amandes ; alors que sa sœur était


















