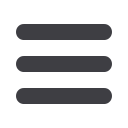

1224
*17-5-2000, Auroville :
Comment exprimer correctement, avec des mots surtout, cette perception, cette
saisie de compréhension ?
Il y a beaucoup de choses que l’on sait inacceptables : il est entendu qu’on le sait ;
cela est considéré comme une évidence.
Pourtant, à l’examen attentif, on s’aperçoit vite que ce savoir est, sinon superficiel,
du moins incertain ; comme s’il était mal fondé, ou fondé sur un terrain instable et
mouvant.
Par exemple, il est universellement entendu que l’on considère la torture comme
inacceptable, et que l’on peut, sans ciller, professer de la condamner.
Pourtant, n’y a-t-il pas des circonstances particulières qui, exceptionnellement,
peuvent justifier la pratique et l’usage de la torture, la légitimant pour la
sauvegarde d’un ensemble collectif, d’une société, voire d’une civilisation ?
Et puis, n’y a-t-il pas des formes pernicieuses de torture mentale et psychologique
infligées plus ouvertement dans nos sociétés ? Qui peut juger parmi ces formes de
torture laquelle est la plus nocive et la plus condamnable ?
Et l’on est bientôt confronté à tout le réseau complexe des responsabilités, des
rôles et des fonctions et des limitations individuelles – où est la faute, où est, qui
est, l’auteur de la faute ? Celui qui, au risque de sa vie, doit obéir aux ordres
donnés et obtenir à tout prix l’information demandée ? Celui qui, choisi pour sa
vulnérabilité spécifique à cette forme de perversité, doit exécuter ? Celui qui, dans
l’ombre du dédale administratif, doit caractériser la stratégie suggérée ? Celui qui,
protégé par la position qu’il occupe dans la hiérarchie, peut prétendre ignorer les
implications des directives qu’il transmet ?
Peut-on encore déclarer avec la pureté convaincue de l’innocence que toute forme
de torture est inacceptable ?
Ce savoir dont nous nous réclamions était constitué autant par la convention que
par l’instinct, par le contrat intellectuel autant que par le sens de la décence, par la
morale autant que par la peur. Ce savoir n’était pas le fruit d’une expérience
directe : c’était, comme la plupart de nos savoirs, la fixation confortable d’un
assemblage composite de notions non vérifiées, de préjugés transmis et d’une
vague éthique liée à notre identité collective.
Un savoir n’est solide et son évidence n’est vivante que s’il a été pleinement
rencontré, mesuré, réalisé par la conscience.
Alors ce savoir est-il un avec la flamme qui rayonne au fond de nous ; plus rien ne
peut le compromettre ni le remettre en question : il ne peut que grandir et devenir
plus conscient, et acquérir une force de vérité plus effective.
C’est une saisie de cet ordre qui m’est venue, devant ce fait de la séparation, de la
dissociation – de cette consécration perpétuellement reproduite de l’abîme entre
nos âmes et nos corps, entre le souffle et la forme, la conscience et sa
manifestation.
Il faudrait, pour décrire cet inacceptable, y venir de plusieurs perspectives à la fois.
Ce n’est pas la mort en soi, c’est-à-dire le retrait, ou la disparition, qui est
inacceptable : il y aura probablement toujours d’excellentes « raisons » de se
retirer, de se refondre, de se rassembler dans le silence de l’immuable et absolu, de
replonger par-delà toute forme.
Ce qui est inacceptable, c’est cette profonde injustice, l’emprise de cet ancien
arbitraire, qui nous oblige à la loi d’une formidable perversion : celle de la
réification de la matière.
La matière nous accueille, se modèle à notre spécificité, nous abrite, nous nourrit et
nous protège, et nous l’utilisons, la revendiquons, la consommons, lui imposons


















