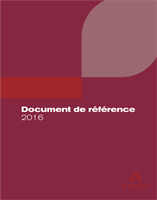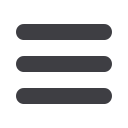

ANNEXE 3 RESPONSABILITÉ SOCIALE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE
A3
2. Informations environnementales
AREVA effectue annuellement de l’ordre de 100 000 mesures et analyses à
partir d’environ 1 000 points de prélèvements pour assurer la surveillance de la
radioactivité dans l’environnement autour de ses sites.
Rejets aqueux
Les rejets aqueux d’azote et d’uranium sont directement liés aux niveaux d’activités
et à la nature des produits traités dans les installations du groupe.
AREVA NC la Hague représente le flux principal des rejets du groupe en azote
(environ 550 tonnes par an). Ces rejets sont directement liés au niveau d’activité
du site (utilisation d’acide nitrique dans le procédé). Ils ont diminué depuis l’origine
des nouvelles usines avec la mise en œuvre, à la fin des années 1990, d’une
gestion des effluents visant à favoriser le recyclage de l’acide. Depuis, ils sont
relativement constants.
Les rejets d’uraniumde l’ensemble des sites du groupe dans les milieux aquatiques
sont stables depuis plusieurs années. Les variations observées sont essentiellement
dues aux anciens sites miniers, à l’arrêt, dont les rejets résiduels en uranium varient
selon la pluviométrie.
Rejets atmosphériques
Certains rejets gazeux liés aux activités du groupe contribuent au réchauffement
climatique, à l’appauvrissement de la couched’ozone et à la pollution atmosphérique.
Il s’agit principalement :
p
des émissions directes de gaz à effet de serre (GES) liées à la combustion
d’énergies fossiles (CO
2
) ainsi qu’aux rejets azotés (N
2
O) des activités liées au
traitement de l’oxyde d’uranium ;
p
des émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à la consommation
d’électricité et d’énergie thermique ;
p
des rejets gazeux tels que les composés organiques volatils (COV), les gaz
acidifiants, les gaz appauvrissant la couche d’ozone.
Rejets de gaz à effet de serre (GES)
Depuis sa création, le groupe a conduit une politique très volontariste de réduction
de ses émissions directes de gaz à effet de serre. La politique environnementale
actuelle vise à maintenir ce haut niveau de performance en termes d’empreinte
environnementale.
Parmi les actions nouvelles mises enœuvre en 2016, il peut être cité le changement
du mode de transport de l’UF4 du site d’AREVA NC Malvésy vers AREVA NC
Tricastin (par voie ferroviaire).
Les émissions directes de GES s’élèvent en 2016 à 396 755 tonnes équivalents
CO
2
par rapport à 526 865 tonnes équivalentes CO
2
en 2015. Cette baisse est
liée au démarrage de Comurhex II, sur la plateforme du Tricastin depuis juin 2016.
Il n’y a pas eu de bilan carbone réalisé récemment permettant d’identifier les gaz
à effet de serre lié au scope 3.
Rejets radioactifs
Les rejets radioactifs ont fortement diminué au cours des trente dernières années,
du fait de démarches de progrès continu déployées dans les entités du groupe. Par
exemple, l’impact radiologique du site de la Hague a été divisé par un facteur de
cinq à sept sur 30 ans : l’impact sur le groupe de référence qui était d’environ 70 μSv
en 1985 s’est stabilisé autour de 10 μSv/an depuis plusieurs années désormais.
Ces efforts ont permis d’anticiper le renforcement des normes réglementaires dans
l’Union européenne, transposées en droit français, qui fixent actuellement la limite
maximale de dose efficace ajoutée par an sur le public à 1 mSv (à comparer
à l’exposition naturelle moyenne en France d’environ 2,9mSv/an (source IRSN,
2016), et dans le monde entre 1 et 10 mSv/an). AREVA poursuit néanmoins ses
études sur la faisabilité d’une réduction supplémentaire des rejets radioactifs de
l’usine de la Hague, notamment dans le cadre de l’arrêté de rejets de l’usine.
Ces actions s’inscrivent également dans le cadre de la démarche ALARA (
As
Low as Reasonably Achievable
: aussi bas que raisonnablement possible compte
tenu de l’état actuel des connaissances techniques des facteurs économiques et
sociaux) et l’application des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) dans des
conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en compte
les caractéristiques de l’installation, son implantation géographique et les conditions
locales de l’environnement.
Les rapports environnementaux publiés depuis 1995 par les sites nucléaires
français du groupe et les rapports annuels de sûreté mis à disposition du public
en application de l’Article L. 125-15 du Code de l’environnement détaillent les rejets
radioactifs et leurs évolutions. Les mesures de ces rejets font l’objet de contrôles
croisés et de contrôles inopinés par l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’impact radiologique des sites nucléaires sur les populations riveraines susceptibles
d’être les plus exposées (groupes de référence) est estimé chaque année. Il
s’exprime en dose efficace ajoutée, dont l’unité est le millisievert par an (mSv/an),
et représente un indicateur d’impact sanitaire. Ce calcul d’impact radiologique
est réalisé à partir des rejets radioactifs liquides et gazeux réels mesurés lors de
l’année écoulée, et prend en compte les différentes voies d’exposition possibles
des populations concernées.
Le modèle d’évaluation de l’impact radiologique de la Hague prend en compte
les différents types de rayonnements (alpha, bêta et gamma), les deux voies
d’exposition possibles (exposition externe, exposition interne par ingestion et par
inhalation) et le comportement spécifique de chaque radionucléide dans le corps
humain. Il résulte de travaux concertés avec des experts français et internationaux
et des mouvements associatifs réunis au sein du groupe Radioécologie Nord-
Cotentin (GRNC). Conformément aux recommandations du GRNC, le site réalise
annuellement une analyse de sensibilité. L’impact radiologique est calculé pour
cinq communes autour du site (lieux d’implantation des cinq stations villages).
Si l’impact sur l’une des communes est supérieur à celui sur les populations de
référence, sa valeur est rendue publique. Des experts externes ont mené des
études épidémiologiques pour évaluer directement l’impact sanitaire des rejets
radioactifs sur les populations exposées. Depuis vingt ans, toutes ont conclu au
très faible impact du site (dose efficace ajoutée sur une année équivalente à environ
une journée d’exposition à la radioactivité naturelle dans la région du Nord-Cotentin).
Le groupe s’est fixé pour objectif d’optimiser sa maîtrise des impacts radiologiques
et d’étendre l’harmonisation des modèles d’évaluation de l’impact radiologique à
tous les sites qui ont des rejets radioactifs, en tenant compte des spécificités locales,
comme les habitudes de vie et de consommation. L’ordre de grandeur des impacts
des installations nucléaires du groupe est très faible, inférieur ou de l’ordre de
0,01 mSv
(1)
.
En France, AREVA apporte tous les éléments d’information nécessaires aux
Commissions locales d’information (CLI) mises en place par les pouvoirs publics
à proximité des grands équipements énergétiques pour favoriser les échanges
avec les populations locales.
Le groupe met aussi en œuvre des dispositions pour limiter autant que possible
l’impact de l’irradiation externe ajoutée en limite de propriété à 1 mSv/an (scénario
théorique extrême d’une personne restant en permanence pendant un an, soit
8 760 heures/an, en limite de propriété du site). En cas d’absence de solutions
acceptables sur les plans économique et social, des scénarios d’exposition plus
réalistes sont pris en compte. Pour vérifier la pérennité du dispositif de réduction
de la dose à la clôture, les sites ont mis en place un suivi renforcé par dosimétrie
lorsque cela s’avère nécessaire.
(1) À comparer à l’exposition naturelle moyenne en France qui est de l’ordre de 2,4 mSv.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
349