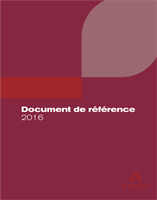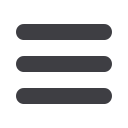

ANNEXE 3 RESPONSABILITÉ SOCIALE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE
A3
2. Informations environnementales
Les opérations d’assainissement du site de Miramas ont pris fin le 31 octobre
2015. Les unités d’exploitation comme la station de lavage et l’unité de dépollution
pyrotechnique sont en cours de repli et le site est en phase de nettoyage final. Les
dossiers de fin de travaux ont été transmis à la Préfecture pour instruction. Le site
s’emploiemaintenant, avec les partenaires locaux, à l’étude de sa réindustrialisation
par sa cession. Le site a été sans activité en 2016, excepté le repli de l’UDT et le
démantèlement du bâtiment associé qui sont soumis à une procédure juridique.
2.2.3.
LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES ET DES
RISQUES CHRONIQUES
À chaque étape du cycle de vie d’une installation nucléaire (création, modification,
arrêt et démantèlement), l’étude d’impact de celle-ci est mise à jour. Ces études visent
notamment à caractériser les effets potentiels sur la santé et sur l’environnement
des rejets et des nuisances de l’installation considérée.
Parmi les études réalisées, celles sur les évaluations des risques chimiques
s’intéressent aux populations riveraines susceptibles d’être exposées de façon
chronique aux rejets de l’installation. Elles sont réalisées à partir de scénarios de
fonctionnement normal des installations, tant en France qu’à l’étranger, et tiennent
compte des différentes voies d’exposition possibles des populations riveraines, dans
le cadre d’approches les plus réalistes possible. Elles sont renouvelées à chaque
modification notable des installations, à la lumière des dernières connaissances
scientifiques disponibles.
La prévention des risques pour l’environnement repose également sur des
études d’impact, établies grâce aux méthodologies d’évaluation de risques pour
l’environnement (protection de la faune et la flore). Elles sont également réalisées
pour chaque nouvelle installation, et pour tout changement notable dans des
installations existantes. Pour ces dernières, la surveillance environnementale
réglementaire intègre également des dispositions adaptées pour évaluer l’impact sur
l’environnement (par exemple suivi des traceurs radiologiques et/ou chimiques dans
différentes matrices environnementales, complété le cas échéant de dispositions
relatives à un suivi écologique de la faune et de la flore). Le site du Tricastin a, par
exemple, complété son suivi environnemental réglementaire par des dispositions de
suivi écologique, spécifique aux enjeux écologiques locaux (réalisation d’inventaires
réguliers et d’indices écologiques normés).
Concernant le risque amiante, la directive amiante du groupe, ayant fait l’objet en
2014 d’une révision prenant en compte les évolutions réglementaires et les retours
d’expérience des sites, a été déployée en 2015. La directive « CMR » (cancérogènes,
mutagènes, reprotoxiques) est applicable depuis septembre 2008 sur tous les
établissements où le groupe est l’opérateur principal. Elle comporte deux volets,
un lié à la gestion des risques aux postes de travail, et un autre lié à la gestion des
risques vis-à-vis de l’environnement. Les objectifs de cette directive sont notamment
d’identifier et de supprimer (lorsque techniquement et économiquement possible)
tous les CMR classés 1A et 1B, ainsi que de maîtriser la traçabilité des expositions
des salariés par la mesure et le suivi.
La prévention du risque de légionellose reste également un axe prioritaire pour les
entités concernées, notamment pour ce qui concerne les réseaux d’eaux chaudes
sanitaires.
Enfin la prévention des nuisances plus spécifiques de type impact sonore, olfactif,
lumineux et visuel est gérée localement par chaque site, en fonction des enjeux
locaux (présence ou non d’habitations à proximité immédiate des sites), des
contraintes locales et des exigences réglementaires.
2.2.4.
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET CHIMIQUES
La loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et
naturels ainsi qu’à la réparation des dommages et ses textes d’application, a conduit
à la mise en œuvre d’un nouvel outil pour maîtriser l’urbanisation autour des trois
sites Seveso « seuil haut » du groupe en France (installation de défluoration de
l’établissement AREVA NC Tricastin, installations de conversion d’AREVA NC
Malvési et Tricastin, AREVA NP Jarrie). Il s’agit du Plan de prévention des risques
technologiques (PPRT), qui permet de réduire les risques, traiter des situations
existantes et gérer l’avenir et stimuler le dialogue avec les parties prenantes, incluant
les collectivités territoriales.
Conformément au 2
e
axe de la politique environnement AREVA, l’accent est mis
sur la prévention et la maîtrise des risques environnementaux, en particulier les
risques opérationnels basés sur la mise à jour périodique des études de danger
des sites industriels (cf. Section 4.4.2.1.
Risques Seveso
).
2.3.
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
2.3.1.
L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES,
DES SOLS ET DES MATIÈRES PREMIÈRES
Utilisation durable des ressources
L’objectif deminimisation de l’empreinte environnementale se traduit par des actions
de réduction des prélèvements dans les milieux naturels et des consommations de
matières et d’énergie, et par une recherche constante des possibilités de valorisation
des déchets.
Au niveau des projets, la démarche d’écoconception d’AREVA a permis d’évaluer
au plus tôt les impacts environnementaux de projets majeurs et ainsi de réaliser
des optimisations, notamment pour des projets portés par les BU Mines, Chimie/
Enrichissement et Recyclage, avec l’appui des ingénieries du groupe.
Les chapitres qui suivent relatifs à la maîtrise de la consommation d’énergie
d’AREVA, à la réduction des prélèvements d’eau et à la gestion des déchets du
groupe donnent des exemples concrets de réalisation permettant une utilisation
durable des ressources en limitant au maximum la consommation de matières
premières.
Utilisation des sols
AREVA est consommateur d’espace au sol de par ses activités industrielles et
minières. Si l’emprise foncière des principales activités industrielles n’évolue
quasiment pas au niveau du groupe, celle liée aux activités minières dépend
directement des technologies d’extraction mises en œuvre : une mine souterraine
ne nécessitera que peu d’emprise foncière par comparaison avec une mine à ciel
ouvert, qui aura besoin de plus d’emprise au sol. Les voies de communication
et les réseaux associés aux installations peuvent également avoir une influence
sur l’utilisation des sols. AREVA est conscient de ces enjeux et s’efforce de les
minimiser.
Par ailleurs, il est important d’intégrer le cycle d’une exploitation dans la démarche
de gestion de l’espace. En effet, les conditions de remise en état, après exploitation,
vont conditionner le retour à un état d’équilibre stable. En France, où l’exploitation
minière est arrêtée depuis près de 15 ans, AREVA gère environ 250 anciens sites
miniers, soit environ 14 000 hectares de terrain. Les anciennes mines ont toutes
été réaménagées et re-végétalisées, pour limiter leur impact résiduel et faciliter leur
intégration paysagère, tout en restaurant des habitats pour favoriser le retour des
346
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016