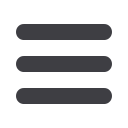

481
Le corps innombrable de la forêt d’un même souffle se penche, la clairière est une
onde prête à sertir ce mouvement que je n’ai pas encore fait.
De la main je sens l’écorce qui presse, et la pulsation d’une veine.
A quelques pas le calme du glaive, l’homme en repos, sa présence grandit dans
mon sang, le flux d’un appel.
La forêt autour de moi est tout intense de vie retenue, mon cœur bat tout seul, la
légère brûlure d’une ronce à ma jambe.
En arrière, invisiblement, des craquements de brindilles, sous le poids furtif
innocent des petites créatures de la branche et du bois.
Il semble que tout sait.
Que cet homme, couché, immobile, n’est plus seul de lui-même, qu’il y a moi.
Il semble que la forêt, la clairière, la lumière, le temps fassent de la place à quelque
chose qui est lui et moi, comme un grand corps ferait le vide entre ses atomes,
pour un autre évènement.
Comme deux comètes de natures semblables, dans un univers d’étoiles en
mouvement, inévitablement se trouvent, et tout accepte le changement qu’elles
portent.
Je ne sais plus ce qui a guidé ma marche à l’aube, je ne sais plus pourquoi j’ai
quitté le sentier, suivi le tapis d’aiguilles, de mousse et de glands.
Je ne sais plus que j’avais un peu froid, ni de quelle clameur je viens.
Je sais seulement qu’il est là.
Et que je ne sais pas encore commettre le pas en avant, l’intrusion de son mystère,
ou répondre à l’appel sans mots ni voix de son sang, de la présence qui coule en
son corps.
C’est la forêt, c’est le soleil plus haut qui me calment.
J’ai envie de me mettre à genoux, de laisser, de flotter, d’entendre bien.
La lumière ne vient pas jusqu’à moi, comme du mercure d’or elle s’arrête, tout
près, au nœud d’une racine presque blanche, je pourrais tendre mon bras, du doigt
la toucher.
Doucement je m’accroupis, m’adosse au grand tronc.
Il y a tous ces degrés jusqu’à lui.
Il y a l’air à ma peau, mes muscles qui parlent, ma salive, et mon corps est aussi
une forêt, qui s’ouvre et reçoit le message, qui s’imprègne de la clairière et de
l’homme étendu qui la change et l’emporte, de ce glaive blanc, et gris, blanc de
brillance, gris de substance, comme un regard parallèle pour l’homme endormi.
Il y a les aspérités sur le corps de l’arbre qui s’enfonce dans, dessous la terre brune
et vaste, toute cette vie qui vit autrement, la libellule qui passe d’une herbe à une
autre, la moisissure au creux du bois.
Ces couches et ces couches de substance, autrement animées.
Il y a la petite foule en joie des boutons d’or, moitié d’ombre moitié de soleil, un or
qui sourit, tout plein et clair du côté ombre, un or qui rie, pétille et se fond, du côté
de lumière et, plus petites, un peu cachées, ou seules dans le vert et le dru, de
menues créatures bleues et violettes, toutes tendres dans l’ombre et la lumière.
Puis il y a, comme un acte qui attend, la distance éclatante jusqu’à lui, immobile.
Son corps un peu enfoncé dans la force de l’herbe ou soulevé par elle, comme en
l’écume de la terre qui nous porte et nous fixe dans nos formes.
Il y a, du rouge et du bleu, profonds, et du brun, comme du velours contre sa peau
claire, là, à quelques pas, à quelque temps.
Et tout bat.


















