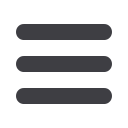

1158
Comme j’ai eu froid ces premières heures, ces premiers jours ; froid de corps et
froid de cœur : la solitude de chacun, cette courtoisie qui rend la vie supportable,
qui civilise l’absence.
*22-12-1999, Auroville :
Comme ces premières images sont frappantes. Des individus, comme exactement
dessinés, reliés par une politesse délibérée, serviables, dont la fraternité est
précisément mesurée, et si profondément seuls.
Des solitudes reliées par un contrat d’humanité qu’il faut bien rendre au moins
tolérable, comme si chacun portait sa niche sur son dos – distincte et poliment
démarquée, essentielle dans un monde sans merci.
Et partout, comme en bloc, l’absence : une absence incompréhensible, comme une
erreur énorme devenue réalité.
Ces petites gares impeccables, ces rangées de maisonnettes proprettes, ces
autobus luxueux presque silencieux et aux trois quarts vides, la gentillesse exacte
comme une monnaie bien comptée des hôtesses et des chauffeurs et des gardiens
et des guichetiers, et l’instrumentation de la vie qui, comme en un jeu de miroirs,
se répète identique à chaque reflet ajouté, et cet objet qu’on investit maintenant
d’une proximité recouvrée, le téléphone portable : la bouée de secours dans la
marée de l’anonymat dévorant qui dicte à tous et chacun les lois, les règles et les
valeurs d’un quotidien rongé par l’absence.
L’absence, comme un couvercle tiré, un ciel trop bas, plombé.
J’étais comme abasourdi, effaré par le pouvoir de l’argent, son absoluité ;
parachuté là brutalement, je ne pouvais m’empêcher de comparer ce qu’on appelle
délicatement « le coût de la vie », là d’où je venais, comme de l’autre côté de l’air
dans ce grand chaos irrésistible et chaud de vie, de mort, de pourriture et de
naissance où mes corps triment et sourient et dorment et endurent et débordent et
dansent et s’appellent et se trouvent et se trompent et se mêlent et s’abîment et
recommencent. J’étais là, pas en très bon état, une sorte d’anomalie déposée sur
l’asphalte lissée, comme un faisceau d’aiguilles en quête fragile, paralysée, d’une
réponse magnétique quelque part dans ce tissu bien ordonné.
Et d’abord c’est ce qui dépassait des rangs que je remarquais : les voix trop fortes,
juste un peu abandonnées, juste un peu récalcitrantes d’adolescents marchant sur
la route, leurs gros tennis de règlement scandant le rythme inaudible de leur
walkman vissé sous la casquette, ou bien cet idiot paraplégique qu’accompagnait
vertueusement un monsieur bien mis le long du quai désert, cet idiot dont les
quelques gestes saccadés et la salive dégoulinante semblait dénoncer toute la
somme des non-dits, de l’inavoué, de cette entière société en vitrine.
C’est plus tard que j’ai commencé de respirer, comme à une profondeur tue dans
les regards, ou un peu en amont du courant qui anime les gestes habituels, comme
un besoin… une luminosité potentielle encore neutre, parsemée, imprévisible,
étrangère à toutes nos logiques, qui se met, ici et là, à vibrer ; rien de
spectaculaire, rien qui s’impose, rien qui veuille, quelque chose d’essentiellement
libre, libre de tout caractère comme de toute forme et pourtant purement besoin.
Un besoin qui donne et se donne, qui est don autant qu’il est appel, qui est
conscience.
J’ai commencé de le percevoir non seulement dans les yeux et les gestes, mais
dans la vie même…


















